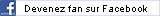Entretiens autour de Mort Cinder avec José Munoz
No Comments »Entretien réalisé par Yann Bagot
José Munoz, Grand Prix du Festival international de la bande dessinée, décerné en janvier 2007 au festival d’Angoulême pour l’ensemble de sa carrière. Je (Yann Bagot) rencontre M. José Muñoz le mardi 20 février 2007 dans un café, à Paris. Né à Buenos Aires en 1942, il fut l’élève et ami de Breccia et travailla avec OEsterheld. Il vit en Europe depuis 1972.

Yann Bagot : Quelle est la situation de la bande dessinée en Argentine lorsque paraît Mort Cinder?
José Muñoz : En 1962, Mort Cinder est publié dans l’hebdomadaire Misterix, dans sa deuxième époque, après que la maison d’édition Yago l’ait eut racheté aux éditions Abril. A ce moment, je collaborais à ce journal; j’avais 21 ans. A cette époque, ce n’est pas le meilleur moment de la bande dessinée argentine. Misterix est une tentative isolée d’un éditeur, mais la presse du secteur avait chuté en qualité, la période fut très obscure pour le monde de la bande dessinée. Les magazines de BD s’étaient raréfiés après l’apparition massive de la télévision. Dans les maisons d’éditions, la plupart de ceux qui faisaient de la BD à cette époque n’étaient pas capables d’avoir une opinion de soi-même et se sont laissés humilier. Chez les éditeurs, il y avait beaucoup de gens incultes, très peu d’argent, manque de respect généralisé. D’un point de vue économique, dans les années 1940/1950, les ventes atteignaient 350 000 exemplaires, vendus chaque semaine, mais vers 1965, 20 000 exemplaires seulement pouvaient être vendus. Breccia faisait son travail, et le publia pour le constater.
Y.B. : Une des singularité de Mort Cinder réside dans la somme d’autoportraits saisissants que nous présente Breccia…
José Muñoz : Chez Breccia, son désir de faire bien le porte à penser que chaque dessin qui appartient à un système narratif, doit resister au regard s’il en est isolé. Dans le cas des autoportraits qui jalonnent Mort Cinder, on doit simplement penser que le visage de Breccia était très intéressant à dessiner. Breccia s’en est rendu compte (rires). Son visage était très impressionnant. Le passage du temps avait transformé son visage. Il semblait comme une statue ambulante, comme fait de pierre et de chair mélangée. Une chose… mythique! Dans des détails moins poétiques, je me rappelle quand don Alberto me racontait comment il faisait pour se raser… Il devait se travailler le visage avec les mains pour pouvoir ouvrir tous les plis de sa peau!
Les beaux dessins sont exigeants. Il était très pointu. C’était un professeur très exigeant avec nous. Pendant ses cours, nous étions 20 ou 30 étudiants entre 12 et 34 ans, il y avait une grande énergie, une grande folie. Le vieux Breccia maintenait l’ordre sur les sauvages en disant: «Ici, on travaille».
Y.B. : Le «vieux Breccia»…Pourtant, nous sommes en 1960, Breccia vient d’avoir 40 ans; Il n’est pas si vieux?
José Muñoz : Pour un garçon moyen de 18 ans, les quarantenaires sont inexplicables…Son visage à 40 ans était déjà très caractéristique. Très… dessinable. Il y a des visages beaux et réguliers qui deviennent plus tard des ballons sans forme. Le sien était celui des anciens sages de la tribu comme Einstein et Beckett… Un visage très attractif.
Y.B. : Quelle est la part d’intervention de Breccia dans le scénario, et celle de OEsterheld dans les images?
José Muñoz : OEsterheld avait un très bon oeil, un oeil très cultivé. Il était capable de comprendre quel univers graphique correspond à une histoire, et vice versa. C’était un lecteur d’images, un écrivain avec une grande culture plastique, ce qui est, selon mon expérience, plutôt rare parmi les écrivains. Il regardait les univers de ses différents amis dessinateurs, puis il leur écrivait des histoires différentes. Par exemple, Pratt était passionné par le XVIIIe siècle aux Etats Unis. Pendant huit ans ils ont fait ensemble les Ticonderoga avec beaucoup de documentation et d’informations sensibles que Pratt avait fournies à OEsterheld.
Dans le cas de Breccia, OEsterheld s’est adapté à son univers très nocturne, expressionniste, tragique. Dans le ciel de la pampa, depuis que Breccia et Pratt ne sont plus avec nous, ils sont devenus des nuages qui nous saluent. Breccia et Pratt sont simplement la nuit et le jour. J’arrange les choses comme ça, de façon animiste… (rires). Pourtant, Breccia et Pratt étaient très proches. Je trouve que Pratt a le même niveau d’exigence, dans une autre famille, mais très proche de la famille de Breccia; pour moi, ils sont mélangés, mais c’est mon affectivité, ma tête, mon expérience. Je ne dis pas que Breccia a joué un rôle dans la structure finale de la narration, mais je suis sûr que Breccia et OEsterheld ont parlé beaucoup pendant la conception de Mort Cinder, et Breccia a aussi illustré Héctor avec ses mots pour arriver à donner un résultat aussi excellent.
Y.B. : Breccia est il le premier auteur de BD à revendiquer aussi fortement l’héritage des beaux arts?
José Muñoz : Non, Pratt avait une démarche similaire. Hogarth, aux Etats Unis, avait un dessin classique et revendiquait frénétiquement l’héritage de la renaissance italienne, de Michel-Ange. Beaucoup ne sont pas interessés par ce genre de revendications, parce qu’ils sont sûrs de pouvoir faire un travail avec des implications artistiques! Mais lorsque la conversation se réchauffe autour d’une table, c’est possible que les revendications apparaissent…
Y.B. : Dans Mort Cinder apparaît une notion de «polyculturalité» à travers l’évocation de ces mondes si différents: le pénitencier américain, le bateau de pirates, la bataille des Thermopyles, la tour de Babel… D’où vient ce mélange des genres et des cultures?
José Muñoz : Le mot «polyculturalité» est très intéressant au regard de la société argentine. L’Argentine est un pays qui a reçu beaucoup d’immigration, le peuple argentin est très cosmopolite. On respirait à Buenos Aires des morceaux d’air de tous les pays, de toutes les cultures du monde. C’est pour nous très naturel de passer de l’héritage culturel d’un pays à un autre. Quand je suis arrivé en Europe, j’ai été choqué de voir que les cultures ne se mélangeaient pas: j’avais l’impression qu’on rencontrait seulement les allemands en Allemagne, les Français en
France, les Espagnols en Espagne… Dans notre quartier, tout était mélangé; aussi, pour nous Argentins, le mélange est la normalité. D’une maison à l’autre, les langues, les cultures, les cuisines, la distribution des espaces, les types de décoration, les meubles, tout changeait. Le quartier était comme un grand parc cosmopolite. Chaque maison de notre quartier était un fragment du monde. D’un point de vue anthropologique, c’était la démonstration que nous pouvions vivre ensemble en gardant nos identités respectives, en les mélangeant, en jouant avec les déguisements identitaires comme dans un carnaval… C’est mieux d’avoir dix identités qu’une seulement… On peut faire le raciste
avec soi-même! Breccia était un immigré uruguayen, presque Argentin, ce brassage culturel était aussi profondément ancré en lui.
Y.B. : Y-a-t-il d’autres auteurs de bande dessinée qui se sont employés à exprimer avec autant de richesse cette polyculturalité en changeant d’écriture graphique de multiples fois au cours d’une même histoire ?
José Muñoz : Non, le cas de Breccia est extrême. Il changeait son style au fil de ses continuelles expérimentations. Le cas de Pratt est plus calme, plus diurne. Il a changé dans la distribution des taches aux cours des années; quand on observe comment il dessine un arbre en arrière-plan tout au long de sa carrière, on peut percevoir l’évolution du rythme de son pinceau et de son élan graphique, très élégant. Dans le cas de Breccia, il employait tout ce qui se trouvait autour de sa planche comme outil qu’il trempait dans l’encre !
Y.B. : Vous avez vu Breccia travailler ?
José Muñoz : Oui, je l’ai connu à l’âge de 12 ans, j’étais son élève jusqu’à l’âge de 14 ans, après je l’ai fréquenté à son atelier. Breccia travaillait pendant dix heures par jour penché sur ses planches, sans se relever. A cette époque, je faisais des tâches sur une petite table à côté de la sienne, mais je faisais aussi son serveur de maté (infusion populaire en Amérique du Sud, ndlr)! Breccia avait une capacité de travail exceptionnelle. Il créait et finalisait jusqu’à trente cases par jour, comme Pratt et Solano Lòpez Il travaillait à l’époque, à la fin des années 1950, pour un hebdomadaire, Patoruzito, dans lequel il publiait une bande dessinée qui s’appelait Vito Nervio, sur un texte de Wadel. Les dessinateurs, à ce moment là, étaient payés à la case. Breccia avait quatre enfants, sa femme était tombée malade, il travaillait énormément pour faire vivre sa famille.
Y.B. : Le climat de Mort Cinder est sombre, expressionniste. Cette atmosphère tragique fait elle seulement référence à sa situation personnelle, ou est-elle une forme d’anticipation des dictatures terribles qu’allait connaître l’Argentine quelques années plus tard ?
José Muñoz : Bien sûr, Breccia était impuissant devant la maladie qui terrassait sa femme, ces circonstances particulières donnent à cette part de son travail une part de son atmosphère tragique. A ce moment là, la situation politique et économique de l’Argentine était encore assez bonne. Dans l’histoire de l’espèce humaine, les moments de joie alternent avec des moments de sanglants règlements de comptes. L’homme est une espèce très bien dessinée, mais pas très bien écrite… Nous avons un goût excessif du conflit, il y toujours le risque de chute à l’état de bestialité première. La civilisation et la culture sont la défense centrale contre la bête que nous sommes ; nous devons toujours défendre la culture pour défendre notre part d’humanité. Dans le cas de Breccia, on doit plutot penser qu’il était un illustrateur et un autoillustrateur» de la condition humaine. L’histoire de l’Argentine lui donnera tristement raison… L’attraction plastique pour la souffrance et la détresse chez Breccia et d’autres est révélateur de la Beauté dans la détresse. Je me rappelle dans ma jeunesse de mon attirance pour la beauté plastique de la guerre dans les BD de Hugo Pratt. La Seconde Guerre mondiale, les affrontements entre marines nord-américains et soldats japonais étaient prétextes à une danse des tâches d’uniformes des marines, des palmiers… Pratt créait ses planches sous une extraordinaire danse du pinceau. Nous avons été victimes du plaisir de l’illustration de la détresse, de la guerre. La situation de l’Argentine était bonne mais tous les deux ans la démocratie était interrompue par l’arrivée au pouvoir d’un groupe de militaires et d’un plan de réhabilitation nationale pour les vingt prochaines années… Il y avait une forte instabilité politique qui fragilisa beaucoup la démocratie. C’est légitime de voir en Mort Cinder l’angoisse qu’ éprouvait Breccia pour sa situation familiale et celle de l’Argentine. Sa femme mourrait en même temps que la démocratie argentine agonisait dans les mains des fous militaristes.
Y.B. : Le statut de Mort Cinder a-t-il changé au cours de son existence?
José Muñoz : Auprès des initiés européens et argentins de la bande dessinée, Breccia fut toujours très respecté et admiré, mais également très combattu, car il avait des «problèmes artistiques». Il ne se rendait pas compte, pour certains, qu’il ne devait être qu’un travailleur… En somme, il suscitait l’admiration et le rejet, pour les mêmes raisons. Par ailleurs, Breccia était également méprisé par des artistes médiocres, parce qu’il faisait de la BD. En dehors de la BD, autour des autres arts appliqués ou pas, on subit toujours des préjugés sur le classement des arts «purs» et «impurs».
Y.B. : En observant une réimpression d’une planche au format original, on découvre une multitude de gris, de détails, de finesses qui ne sont pas rendus par l’impression originale au format du fanzine. Pourquoi Breccia n’adapte pas son travail à la qualité d’impression qui lui est destinée?
José Muñoz : Breccia travaillait du mieux qu’il pouvait, comme il l’a toujours fait. Breccia a toujours souffert de «problèmes artistiques». Et moi, et plusieurs d’autres de ses élèves, il nous a communiqué cette maladie (rires). Alors, au-delà de l’opinion des ignorants et des passants divers, on tente simplement du faire du mieux que l’on peut. C’est là un enseignement principal de Breccia. Le travail de Breccia tolère la mauvaise impression. Mais le travail de Breccia porte sur la planche originale, pas sur son impression. Une particularité du travail de Breccia, est qu’il ne crée jamais de noir «sans âme», inexpressif. En observant les originaux, on découvre que tous les noirs d’une même image sont uniques. Ils renferment tous presqu’une infinité de nuances de gris, des morceaux d’idées, des vagues de lumières qui dansent au milieu. Chez Breccia ce travail des noirs et des gris commence dans la première BD qu’il fit avec OEsterheld, Sherlock Time. Le premier épisode , La goutte, commence avec des noirs plats qui peu à peu se nuancent de gris divers, gris qui s’enrichissent peu à peu. Lorsque nous avons découvert cette mise en place de BD aux accents expressionnistes, ça nous a coupé le souffle. La nuit, le sang qui coule, le délire nocturne…
Y.B. : Les thèmes du Temps, de la Mort traversent Mort Cinder, et donnent à cette oeuvre une gravité particulière, et renvoie chaque lecteur à sa propre existence. Ce sont là des thèmes chers à OEsterheld?
José Muñoz : Tout le travail de OEsterheld comme écrivain traite du passage du temps, de la construction de l’amitié, de l’aventure humaine. OEsterheld souffrait aussi des problèmes «philosophiques». Ses histoires sont toujours construites à partir des contradictions des êtres vivants, de la condamnation de savoir que chacun d’entre nous mourra, et tente de faire quelque chose de sa vie. On trouve dans ses histoires des échos aux questions que chacun d’entre nous se pose à chaque instant. OEsterheld fut, à ma connaissance, le premier à amener ces thèmes dans la bande dessinée.
Y.B. : Breccia voulait-il consciemment rapprocher les beaux arts de la bande dessinée?
José Muñoz : Non, je ne crois pas que ce soit un propos conscient. Breccia a seulement cherché où il trouvait du plaisir, il l’a trouvé en travaillant ses planches de bande dessinées comme si elles étaient des créations artistiques « pures ». Le débat entre les arts élitistes et populaires est davantage journalistique qu’artistique. J’ai moi-même perdu beaucoup de temps dans ce débat jusqu’au moment où j’ai compris que le conflit n’est pas intéressant. Breccia cherchait simplement comment tolérer son travail !
Y.B. : Pourquoi Breccia a-t-il choisi la voie de la bande dessinée plutôt que de s’accomplir dans la peinture, la gravure, la sculpture?
José Muñoz : Breccia a choisi la voie du dessin pour augmenter ses exigences jusqu’à la fin de sa vie, nous donnant un exemple de persistance dans la recherche du bon travail. La bande dessinée, à l’époque, permettait de gagner de l’argent régulièrement, au nombre des cases réalisées. C’était plus facile de faire vivre une famille en travaillant comme dessinateur de bandes dessinées. Breccia aimait la narration, aimait le noir et le blanc, mais ce n’était pas un mystique de la BD. C’était une grande chance pour notre génération de trouver un tel maître.
Y.B. : Quel regard Breccia portait-il sur l’art qui lui était contemporain ?
José Muñoz : Il aimait, en général, les oeuvres qui mettaient en avant le geste pictural. Il aimait beaucoup les matérialistes, les peintres de la matière. Il devait aimer Rothko. Il était sensible à l’abstraction. Breccia n’était pas très intéressé par le Pop Art. Les artistes des beaux arts du Pop Art ont voulu dédouaner la bande dessinée en aggrandissant des cases peu intéressantes dans des grands cadres, alors que l’artiste de bande dessinée était critiqué s’il faisait la tentative inverse, avec des figurations picturales intéressantes. A l’époque, l’artiste «pur» ennoblit les arts mineurs en les regardant, mais l’artiste «impur» salit les arts majeurs s’il les regarde de trop près… Très journalistique comme connerie ! Le dialogue était impossible. Mais au résultat, Breccia a regardé tout le monde artistique depuis Goya, Hieronymus Bosch, les expressionnistes allemands, puis américains, avec l’expressionnisme abstrait. Il en a créé un monde nocturne et singulier, habité par des taches d’encre. Breccia me parlait beaucoup de Goya, c’est lui qui me l’a fait découvrir. Il a commis le «pêché» d’amener un autre regard dans univers de la BD «commerciale». Faire du commerce – tout le monde fait du commerce – avec le produit que tu veux faire, ça devient artistique! Breccia était un travailleur exigent pour lui et ses lecteurs, il voulait que ses lecteurs réfléchissent en regardant ses images. Il ne voulait pas leur donner des images prédigérées. Je me rappelle en particulier d’un visage qui m’avait frappé lorsque je découvris Mort Cinder, un «oeil de plomb» incroyable. Cette image me hante encore, ce personnage sort de la page en regardant le lecteur. Solano López, le premier dessinateur de l’Éternaute, a aussi réussi souvent à dessiner des personnages qui regardent le lecteur. Mais ces images sont très rares, très difficiles à réussir. Solano López fut par ailleurs celui qui représenta le mieux Buenos Aires. J’étais à quinze ans l’assistant de López.
Y.B. : Pensez-vous que Mort Cinder ait pu jouer un rôle muséologique en promenant son lecteur dans des mondes aussi différents ?
José Muñoz : Oui… Breccia a tenté de populariser les arts majeurs ! Il a commis ce délit ! (rires). Mais si les bonnes choses deviennent populaires, tant mieux. Le musée est la seule façon de maintenir aux yeux des hommes la beauté des oeuvres d’art du passé. D’ailleurs, il manque encore un vrai musée de la BD dans une ville capitale. Pourquoi les musées de la mode et, pire encore, de la publicité, existent, et pas celui de la bande dessinée? On peut regarder le musée comme un cimetière, mais c’est une erreur… La beauté des arts est aussi que les bons travaux sont toujours vivants, que le geste du travailleur renaît sous tes yeux, chaque fois que tu le regardes! (silencieux, regardant la couverture de la réédition française de Mort Cinder) Regarde tous ces gris…c’est incroyable…
Source : Entretiens autour de Mort Cinder, de Yann Bagot